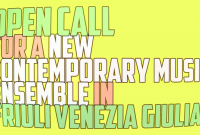Un entretien avec Anne Teresa De Keersmaeker, au sujet de la reprise de Rain à l'Opéra de Paris (2011)
Alors que les récentes productions d'Anne Teresa De Keersmaeker invitent la musique à vibrer en creux, dans le souvenir et le silence (The Song, en 2009, était une chanson muette), ou à ne plus émerger que par instants, dans la grâce vulnérable d'un crépuscule (l'«ars subtilior» de En Atendant, en 2010), la reprise de Rain permet d'apprécier le moment de démesure «polyphonique» - c'est le seul mot qui convient pour nommer ces grandes extases fuguées que sont Drumming et Rain - dans le parcours de la chorégraphe, à la charnière de l'an 2000.
La musique, toujours, avait été son interlocutrice. Et derrière la musique éprouvée dans sa chair vibrante, nouant la danse et le son : la partition musicale, analysée, pesée, étudiée, toute chargée de sortilèges, promesse d'une écriture du sensible. Mais sans doute est-il un peu court de dire que De Keersmaeker «dialogue» avec la musique, et c'est mal la connaître. Elle lui demande quelque chose. Dans un premier temps (entre 1982 et 1985), temps de la rage et du défi, c'était la demande d'un «mur contre lequel se cogner» – ce sont les mots de Thierry De Mey au sujet de Rosas danst Rosas, et des violentes constructions rythmiques qu'il avait composées pour la circonstance.
Le deuxième temps, celui des grandes partitions de la tradition classique (Beethoven, Bartòk, Ysaÿe), peut être vu comme une longue enquête sur les principes musicaux : thématisme, polyphonie sur le modèle du canon, variations. C'est l'époque où s'invente la belle expression de «concert de danse», où les chorégraphies de De Keersmaeker sont autant de témoignages mélomanes, les comptes-rendus incarnés et volages d'une écoute obstinée.
Le temps suivant, dont Rain représente le moment d'équilibre magique, est moment de dénouement : les ressorts formels de l'écriture polyphonique ont si bien été apprivoisés qu'ils ne sont plus regardés que de très loin, et sans plus d'inquiétude. L'écriture chorégraphique trouve une nouvelle aisance, elle surenchérit sur l'oeuvre musicale, elle en complémente le contrepoint à la manière de voix additionnelles. La partition, qui respire dans l'ombre, se laisse encore deviner comme cause absente, mais elle a perdu tout rôle prescriptif : l'écriture a infusé, l'écriture rôde, elle enveloppe les corps d'une présence caressante, d'une parole dans la nuit, d'une fluorescence. Et d'une folie.
On a parfois loué l'équilibre «entre forme et émotion» dans le travail de De Keersmaeker, au risque de l'assigner au royaume du juste milieu, à une équitable gestion d'un bon capital-écriture, tempéré d'un solide savoir-faire expressif. Il serait plus juste de pointer la dimension paradoxale, à la fois structurante et déréglante, de son écriture spiralée, fuguée, proliférante, qui précipite les corps vers le vertige. Virtuellement illimité, infiniment plastique, toujours ouvert sur son point de fuite, l'ordre combinatoire est tout aussi bien puissance de désordre, qui désamorce le fantasme du corps pur. Ce fut rarement aussi vrai que dans Rain.
Jean-Luc Plouvier : Après Fase en 1982 et Drumming en 1998, Rain (originellement écrit pour Rosas en 2001) est votre troisième spectacle entièrement consacré à la musique de Steve Reich. Peut-on parler d'une filiation qui relierait ces trois productions?
Anne Teresa De Keersmaeker - Mes pièces procèdent souvent de circuits généalogiques complexes, qui ne concernent pas que le choix de la musique. J'avais par exemple testé à l'intérieur de_ Just Before_, en 1997, le premier mouvement de Drumming, que j’ai complété l'année suivante. Le vocabulaire chorégraphique d'une seule séquence avait alors fleuri aux dimensions d'un spectacle complet. Ou : ce que j'ai développé dans un contexte théâtral, en le frottant au texte (les Mikrokosmos de Bartok dans Bartok/Aantekeningen) s'est retrouvé plus tard arraché au théâtre, et retravaillé en «danse pure». La situation pour Rain était plus particulière encore : j'ai repris le vocabulaire dansé développé en 2000 pour In Real Time, un long spectacle développé avec les acteurs de Stan et les jazzmen d'Aka Moon, et l'ai totalement isolé de son contexte, y compris bien sûr de ses résonances musicales.
Ce «vocabulaire», comme vous dites, est donc autonome par rapport à la musique qui l'accueille : il supporte sans dommage la transposition du jazz-rock à l’oeuvre de Steve Reich. Le niveau d'abstraction polyphonique, au moment de Rain, est alors chez vous à son maximum. Mais qu'est-ce au juste que ce «vocabulaire»? Un ensemble de gestes, un scénario?
Non, ce sont des phrases. De longues phrases dansées, des séquences de gestes liés dans le temps. La question de l'époque était de lier. C'est avec Drumming que j'ai voulu relever le défi du flow : une seule oeuvre musicale d'une heure, obstinée, soufflant sans discontinuer sur toute une troupe de danseurs qui ne quittent jamais la scène. Une longue polyphonie dansée sans coutures. C'était un problème énorme et passionnant que de construire un grand arc sur cette durée, sans le découper ostensiblement en mouvements, et surtout de faire moduler un groupe sans qu'il ne s'arrête jamais ! J'avais pourtant construit Drumming sur un matériel réduit, une unique phrase dansée, variée de toutes les manières possibles.
Drumming, de Steve Reich, est une oeuvre tambourinée de bout en bout. Music for Eighteen Musicians, sur lequel est construit Rain, est de longueur équivalente, mais son tempo est d'une tout autre qualité : clignotement rythmique stroboscopique des pianos et marimbas, à la fois plus rapide, plus hypnotique et plus doux. La dimension harmonique entre également en jeu.
Dans le parcours de Reich, cette oeuvre de 1976 est en effet neuve et singulière. On y retrouve comme dans_Drumming_ la pulsation continue, bien sûr – c'est le côté «invitation à la danse», la musique qui pousse dans le dos des danseurs; puis les processus clairs et lisibles qui invitent à construire la chorégraphie; mais on y découvre aussi un lyrisme qui est nouveau chez lui, toute la dimension du souffle, ces vagues harmoniques vents-cordes-voix qui viennent submerger le rythme.
Reich évoque l'influence de Pérotin et l'art du cantus firmus : les onze accords donnés dans l'introduction sont à considérer comme une lente mélodie de onze notes. Les onze sections de l'oeuvre sont comme la reprise de cette mélodie, mais ralentie mille fois.
… Et ce découpage invite à une dramaturgie plus complexe, une modulation presque narrative. Une écriture chorégraphique plus riche et plus variée. J'ai d'abord élaboré une phrase dansée comme matrice de base - la plus longue que j'ai jamais conçue : une phrase de deux minutes... C'est une phrase personnelle, typiquement féminine, où je m'autorise des citations de danse classique (la figure de la couronne, par exemple). Elle se développe spatialement en spirale, en s'ouvrant à partir d'un noyau intime. J'ai ensuite demandé aux hommes de me composer une contre-phrase, typiquement masculine, de longueur équivalente, et qui soit sur tous les plans l'opposé de la mienne, ou son négatif : qu'elle traverse l'espace plutôt que de l'ouvrir, qu'elle chute vers le sol plutôt que de s'élancer vers le haut, et ainsi de suite. C'est Jakub Truszkowski qui s'en est chargé. Je disposais dès lors d'un matériau contrasté, à deux faces, là où Drumming était en quelque sorte «monothématique».
Le matériel gestuel est distribué selon les sexes?
Ah non, ce n'est pas si simple ! Chaque danseur doit s'emparer de tout le matériel, masculin et féminin! A l'endroit comme à l'envers. Chaque phrase est étudiée dans son déroulement normal autant que dans sa lecture en rétrograde, comme un film qu’on passe à l’envers. Le circuit de base est celui-ci : déploiement de la phrase féminine, rétrograde, phrase masculine, rétrograde et retour au point de départ.
C'est une forme en «ruban de Möbius», si je comprends bien. Il n'y a plus d'envers ni d'endroit, mais la possibilité de parcourir toute la surface possible, l'envers comme l'endroit, avant de revenir au début.
On peut le dire comme ça. Il y a une préoccupation topologique, en effet, une grande question primordiale sur la manière d'occuper l'espace avec un groupe en mouvement. J'ai rêvé d'une «architecture», mais il fallait enlever à ce mot sa connotation statique, je voulais une architecture mouvante, prise dans le flux, dont la perspective change à tout moment. Le temps fait sans cesse son travail. La figure de la spirale, qui est absolument essentielle pour moi, lie l'espace et le temps : quelque chose insiste et fait reprise, continuellement, mais à chaque retour, la perspective a changé; ce qui était à l'avant-plan est passé à l'arrière-plan, le lointain est devenu proche, le proche est passé au lointain.
Le parti-pris du «bithématisme» suggère une danse symétrique, mais la symétrie est sans cesse évitée.
Voilà. J'utilise la technique du miroir dans le temps (le rétrograde), aussi bien que le miroir dans l'espace (la division du groupe de danseurs en deux parties), mais en gardant toujours une asymétrie. Le groupe de dix danseurs se sépare généralement en 3 et 7, ou en 4 et 6.
Le processus de départ que vous nous évoquiez, celui du grand circuit homme-femme aller-retour, est par ailleurs sans cesse «contrarié»...
J'introduis des «boucles dans la boucle», si vous voulez. J'utilise là le procédé que Steve Reich utilise à plein régime dans _Music for Eighteen Musician_s, celui du «stacking» ou remplissage. Un motif musical émerge petit à petit, note par note, au fil des répétitions. Une note, deux notes, trois notes et ainsi de suite, jusqu'au dévoilement du motif complet. J'ai transposé ce procédé à la chorégraphie.
Dans la musique, les notes remplacent peu à peu les silences. Qu'en est-il pour la danse? Des gestes viennent briser l'immobilité ?
Non, l'équivalent du «silence» en musique est ici la marche. Ce sont des trajets marchés qui, peu à peu, accueillent des motifs dansés, jusqu'à reconstitution de la phrase. La marche et la course, dans leurs différentes vitesses, m'obsèdent. Il suffit de suspendre un mouvement de marche, de le reprendre : et voilà, c'est déjà de la danse. Par ailleurs, la marche comme «degré zéro» de la danse permet de dessiner facilement des trajets dans l'espace, de le couper, de structurer tout le trafic, de dessiner les avant-plans et les arrière-plans. Je travaille là-dessus depuis Amor Constante, en 1994.
Ces «stackings» ou remplissages sont extrêmement clairs dans l'oeuvre musicale, et plus dissimulés dans la chorégraphie.
Oui. J'ai respecté l'oeuvre de Reich dans sa coupe, j'ai été attentif à sa forme en onze sections, mais pour ce qui est des procédés de développement, j'ai pris ma liberté! Les «stackings» se font toujours à trois voix, avec trois danseurs à différentes vitesses. Sur la même durée, l'un fait émerger la phrase de base, le deuxième dévoile la phrase à double vitesse suivie de son rétrograde, le troisième un complexe phrase-rétrograde-reprise à triple vitesse. Cela donne une sorte de curieux canon dont je dois l'idée à Thierry De Mey (que j'appelle traditionnellement mon «dealer», mon fournisseur en stratégies formelles).
Tout cela est calé au chrono, alors ?
Oui. Il y a des écrans avec chronomètres disposés à peu près partout, pour les danseurs comme pour les musiciens.
Pour le spectateur, les procédés assez sophistiqués que vous décrivez là sont des moments d'incertitude et de révélation. On touche presque au chaos, et puis soudain tout s'ordonne, un unisson surgit...
Ah oui? Vous avez cette impression?
… Quoiqu'un unisson ne le reste jamais longtemps!
J'ai beaucoup travaillé, en effet, le «faux unisson», le presque-ensemble, que nous appelons des «kinok» en hommage au cinéaste Dziga Vertov. Vous coupez par exemple la phrase en huit parties égales, huit segments, et vous variez la vitesse de chaque segment en lui assignant un certain nombre de pulsations, basé sur les nombres de la suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... (chaque nombre de la suite étant la somme des deux précédents). Une séquence connue, déjà vue, est ainsi bizarrement «stretchée» avec des accélérations, des ralentissements. Je superpose alors plusieurs phrases égales et de même durée, mais dont les segments sont «stretchés» différemment.
L'occupation de l'espace, les raffinements structurels, semblent prendre le pas sur le détail des corps et la responsabilité de chaque danseur.
Non, ne croyez pas cela. Si vous jetez un oeil sur le tapis de sol, vous y verrez une «spirale de spirales» constituée d'un ensemble de rectangles décalés. Eh bien, chaque rectangle est la «maison» d'un des danseurs. A tout moment, quelle que soit la complexité d'ensemble, un danseur peut «rentrer à la maison» pour ne pas devenir fou, et se retrouver chez lui. Certaines séquences ont d'ailleurs été construites à partir de ce jeu de places : les danseurs vont faire des «visites», par exemple, ou se choisissent des «résidences secondaires» en fonction de leurs affinités avec d'autres danseurs; je veux dire, des affinités dans la vie réelle. Chacun, d'ailleurs, a retravaillé le matériel en fonction de son caractère, de son corps propre, de sa place d'être humain dans la compagnie. Nous considérions que chacun, sur le plateau, était accueilli «tel quel» et s'appropriait le matériel sans le neutraliser, mais au contraire en le chargeant de subjectivité. Chaque danseur est comme un instrument de musique, qui a sa sonorité et sa couleur propres.
Cela pose la question de la transmission de ce spectacle, depuis Rosas jusqu'au ballet de l'Opéra.
Oui. Les choses se sont à ce point subjectivées que chaque danseur est devenu un «rôle» : Alix jouait le rôle d'Alix, Rosalba le rôle de Rosalba... Lorsque Brigitte Lefèvre m'a proposé de tenter la passation de l'oeuvre, nous avons organisé des castings en gardant à l'esprit les «rôles» originaux. Chaque danseur de Rosas a rencontré son «avatar» parisien et travaillé avec lui. Ensuite a commencé le lourd travail de transcription de la chorégraphie, qui a été pris en charge par Jakub Truszkowski, Ursula Robb, Clinton Stringer, Marta Coronado et Cynthia Loemij.
La pièce n'avait donc pas été transcrite sur papier?
Mais comment voulez-vous noter tout cela? C'est presque impossible. Nous disposions par contre d'une importante archive filmée. Une captation prise d'en haut, en plongée, nous a été de la plus grande utilité pour reconstituer les mouvements d'ensemble – ce serait d'ailleurs une idée formidable de faire voir le spectacle, non plus en vision frontale, mais d'en haut, comme j'ai pu le faire au MoMa de New York avec Violon Phase, et les spectateurs sur la galerie au-dessus de ma tête. Nous avions également archivé une captation par danseur, avec la caméra qui le suit du début jusqu'à la fin. Il ne restait qu'à en déduire les intersections... Le travail a été chaud, très chaud !
J'en reviens aux secrets d'atelier. On connaît votre goût pour le «nombre d'or», cette proportion idéale déjà utilisée par les architectes de l'antiquité grecque. L'avez-vous retrouvée dans l'oeuvre de Reich?
Dans la forme générale de Music for Eighteen Musicians, oui, certainement : la propotion d'or correspond à quelques secondes près à l'attaque de la section VI, c'est-à-dire à ce moment de bascule musicale où l'un des percussionnistes (ici, Miquel Bernat) fait entrer une maracas qui fait «swinguer» le tempo. Dans la chorégraphie, c'est le moment où je casse le cadre. Tout le spectacle se déroule à l'intérieur du cercle délimité par le décor en cordes, sauf à ce moment précis où les danseurs passent à travers les cordes, comme une spirale détachée de son noyau, et se ruent vers le dehors dans un flash de lumière. C'est d'ailleurs tout aussi bien le moment de bascule pour les éclairages et les costumes, dont le processus de couleurs s'inverse.
Ah bon, c'est qu'il y a aussi un travail sur le nuancier de couleurs?
Oui, il y a un voyage coloré imaginé par Jan Verweyveld, le scénographe-éclairagiste, et le couturier Dries Van Noten. Dries est parti de la couleur chair, dont il pousse progressivement la nuance fushia, à la faveur de plusieurs changements de costumes. A la section d'or, le rose fushia a pris une luminosité outrancièrement intense, c'est plutôt audacieux, mais ça marche. Cette nuance se décolore doucement jusqu'à la fin du spectacle, où règne alors une teinte argentée. Jeu de spirale, à nouveau : il y a un effet de retour, mais ce n'est pas la case départ, nous sommes décentrés. Le rôle de Dries et Jan a été très décisif, ils ont transgressé les consignes, en quelque sorte, et cela a produit d'excellents résultats! C'est Jan Verweyveld, en concevant ce décor en cordes, qui a fait émerger le magnifique motif du dedans-dehors, d'un espace englobant, mais ouvert sur son au-delà.
Départ de la couleur chair, disiez-vous, c'est-à-dire du corps nu?
Le point de départ était un petit coquillage orange-rose qui repose toujours dans mon bureau. Objet infiniment discret, mais qui dessine une spirale d'une absolue perfection. Tout est parti de là, si l’on veut.
Jean-Luc Plouvier, avril 2011, pour l'Opéra de Paris.
Le titre Parlons travail est emprunté à un recueil d'articles de Philip Roth (Gallimard, 2006).