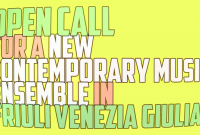Fragments fibonacciens
(Anne Teresa De Keersmaeker et la musique)
par Jean-Luc Plouvier
première étreinte
Avec le deuxième mouvement de Rosas danst Rosas, en 1983, Anne Teresa De Keersmaeker et Thierry De Mey inventent une relation danse-musique inédite. Dans ce fameux et très minimal « quatuor des chaises », tout le développement dansé est complètement asservi à la forme musicale, séquence par séquence, seconde par seconde ; et la musique elle-même est déduite d’un pur jeu de nombres – du moins en ce qui concerne l’essentiel : le rythme et le déroulement temporel. Elle est en outre scandée avec force, presque avec brutalité, dans une couleur sonore très _rock. _Mais en constraste à cette musique doublement impitoyable (par sa sonorité et son chiffrage contraignant), répond un matériau gestuel largement composé de postures érotiques : gestes courts et typés de la séduction – la main qui lisse les cheveux, qui recouvre l’épaule dénudée ; les bras tendus entre les cuisses ; la tête jetée en arrière avec émoi ; l’expiration à bout de souffle. Entre l’impulsion dansée et sa mise en forme, ou, si l’on veut, entre le vocabulaire (propre à la danse) et l’usage qui en est fait (soumis à la musique), la tension est maximale : c’est presque une guerre.
Cette expérience, le premier coup de maître d’une très jeune chorégraphe , donne le ton à l’aventure d’Anne Teresa De Keersmaeker avec la musique : c’est d’abord une histoire de fascination, de guerre et de paix, une étreinte qu’on cherche autant qu’on la fuit.
trop, trop peu
Il s’agit de débrouiller un rapport musique-danse, mais il n’est pas certain qu’un rapport existe. Il ne s’agit pas pour autant de dire qu’il y en a une multitude, plus ou moins habilement dosés, et plus ou moins équivalents. Non, il y a quelque chose de précieux et d’entêté : une demande particulière faite ici à la musique par la danse ; une utopie de rapport ; une fiction de rapport. Quelque chose qui n’a jamais vraiment eu lieu, qui n’aura pas lieu, mais qui produit mille relations intéressantes, à force d’insister. Par excès. Ou par défaut.
Excès : de formalisme, d’analyse, de mise en diagrammes, en schémas ; soumission des corps à une combinatoire, du temps à un découpage, de l’espace à des tracés. Ou alors défaut : de sens, de cohérence, d’unité ; accumulation des événements jusqu’à saturation de l’espace ; irruption soudaine de crises d’hystéries ; déconstruction des lignes de forces en déluge d’anecdotes. Et n’est-ce pas ainsi qu’ils dénigrent son travail, les impatients détracteurs de Rosas - avides d’harmonie, de justesse, d’humanité et d’émotion : trop d’ordre, trop de désordre. Trop de froideur, trop de chaos. Art de la fugue et crises de nerfs.
« une résistance ultime »
Thierry De Mey témoignait récemment (1) de son travail sur Rosas danst Rosas :
« Nous étions à l’époque assez impliqués dans la lecture de Georges Bataille, ses analyses sur la discontinuité qu’introduit le langage au sein de la continuité animale, et toutes les tentatives de réunification où se côtoient extase et transgression. Pour mettre ça en œuvre, il nous fallait d’abord une forme verrouillée à l’extrême, un véritable mur structurel, contre lequel les quatre danseuses viendraient se cogner de toutes leurs forces. La structure, dans ce cas, était une sorte de maître implacable, imposant aux corps la contrainte, la vitesse, la dépense; mais tout le vocabulaire chorégraphique, en revanche, était situé du côté du désir, constitué en grande partie d’attitudes et d’impulsions sexuelles. Tension et contraste, donc, entre une forme froide, prédéterminée, irréversible, courant vers sa fin logique, et le don physique des danseuses, sur-érotisées par la répétition à l’infini d’un petit nombre de figures très fortement connotées. Et glorification, finalement, du corps comme résistance ultime à la mise en chiffres. »
C’est au départ de cette expérience que Thierry De Mey fondera plus tard le sextuor Maximalist! , dont le nom résume brillamment le projet : un minimalisme à l’esthétique inversée. On conserve de la musique minimaliste le déploiement de processus apparents, immédiatement audibles à travers le jeu des répétitions ; mais on répudie l’expérience mystique soft du temps cyclique et de son bercement, et on y substitue l’exaltation d’une dépense physique en pure perte.
Les propos cités de Thierry De Mey frappent par leur charge violente, qui nous ramène à la source d’intuitions créatrices que le temps a apprivoisées, et recouvertes d’une patine « classique ». Construire un ballet, donner forme à la danse, c’était donc pour cette jeune chorégraphe et ce jeune musicien : dresser un mur, s’imposer un maître, disposer des verrous, établir des contraintes irréversibles. Et ces contraintes, ce mur, ce maître, il s’agissait pour les danseuses de s’y cogner de toutes leurs forces en état de sur-érotisation, dans un geste de résistance ultime.
Si l’on veut bien prendre au sérieux ce témoignage, on peut dire qu’en 1983 les choses sont pour le moins nettes : la musique est garante de la forme, qui est affaire de chiffres, qui sont violence et contrainte faite au corps. La danse est garante du désir, qui est transgression, et finalement victoire épuisée sur l’ordre imposé. (Ou, plus justement : sur un ordre sollicité).
Cette radicalité s’est adoucie au fil des oeuvres, elle s’est complexifiée, elle a rusé avec elle-même, elle a cherché des voies plus discrètes. On pourrait dire aussi : la musique s’est faite chantante, elle a su séduire les séductrices, elle a vaincu les résistances. Mais il est difficile de ne pas voir dans Rosas danst Rosas le geste fondateur du style De Keersmaeker, et comme sa fiction de base : la musique délivrerait à la danse la clé de la forme, qui serait une clé chiffrée. Aux corps de s’y soumettre tout en lui résistant de toutes les manières, etde produire in fine un résidu incomptable et glorieux.
mythologie
On dira sans doute un jour d’elle, légitimement, que le plus grand mérite de l’oeuvre d’Anne Teresa De Keersmaeker est d’avoir intensément cherché un nouveau rapport entre la musique et la danse. C’est même, déjà, presque une mythologie : je baigne dans cette rumeur-là, à Bruxelles, depuis que j’ai vingt ans, bien avant que j’en connaisse l’héroïne. La rumeur dit ceci : que De Keersameker n’est pas de ces chorégraphes qui utilisent la musique en tapisserie pour leurs banquets, ni de ces nouveaux riches qui entendent prouver qu’ils ont vibré avec Mahler, ou dîné avec Boulez. Que la musique n’est pas pour elle un décor, un prétexte, un serviteur. Mais que sa danse dialogue _vraiment _avec la musique, qu’elle en épouse les fondements formels, analyse son architecture, éclaircit sa polyphonie. C’est ce _vraiment _qui m’intriguait : j’avais vingt ans, donc, j’étudiais au Conservatoire, et je frémissais lorsqu’on me rapportait les diableries de ces fameux Rosas : ces jolies danseuses connaissaient donc le solfège, l’harmonie et le contrepoint ; en répétition, elles reprenaient spontanément à la mesure 613, et tournaient les pages du violoniste entre deux entrechats.
grandes oeuvres et petites culottes
Avec plus de douceur, avec plus d’humour, le rapport musique-danse de Rosas danst Rosas se vérifie dans Mikrokosmos, en 1987, dans le quatuor de femmes sur la musique du Quatrième Quatuor de Bartok. Anne Teresa avait analysé chaque mesure de cette partition avec le compositeur Walter Hus, soulignant au crayon rouge chaque effet de canon, chaque entrée de thème, repérant toutes les articulations liées à la proportion d’or (Bartok, comme De Keersmaeker, étant très friand de nombre d’or). (2) Calée au cordeau sur la musique, et ce jusqu’à la dernière mesure (ce magnifique recul des quatre filles jusqu’aux chaises du fond de scène, avec affalement définitif et exténué sur le dernier accord), la chorégraphie nie pourtant par son style le sérieux de l’entreprise : les danseuses chuchotent, s’envoient des regards moqueurs de mauvaises élèves, montrent leurs petites culottes – femmes-enfants indomptables et bravaches. Le type d’insolence mis en jeu est cependant sans ambiguïté : ce n’est pas Bartok qui est raillé, ni son oeuvre qui est égratignée. C’est la chorégraphe qui semble se moquer d’elle-même, et s’excuser de sa vanité à s’emparer d’une grande oeuvre jusqu’à en disséquer le fonctionnement. Elle semble se défier de sa propre science, s’en excuser peut-être : elle jouera le jeu de la culture, oui, mais.
Boum les femmes, Hé les hommes
Comme le relève très justement son exégète Marianne Van Kerkhoven (3), l’évocation du féminin chez Anne Teresa De Keersmaeker est toujours plurielle, vibrionnante, indécidée. L’insolente, l’amoureuse, la folle, la stripteaseuse, la ténébreuse - les femmes y sont multiples, leurs masques sont changeants, et l’interrogation sur leur identité toujours relancée. Lorsque j’écris : la musique est pour elle garante de la forme, la danse est garante du désir, je suis pourtant tenté d’ajouter, trop systématique : la musique, affaire d’hommes – et la danse, affaire de femmes (Rosas, on le sait, était une stricte compagnie de femmes juqu’au duo Ducourt-Saunier dans Mikrokosmos, en 1987). Commentaire précipité, bien sûr, qui n’éclaire rien. J’y vois pourtant le reflet d’une tentation présente dans la méditation, le discours, le travail, et même la vie quotidienne d’Anne Teresa De Keersmaeker (jusqu’à son alimentation, me semble-t-il) : tentation permanente de trouver des jeux d’oppositions qui viendraient recouvrir, expliquer, pacifier peut-être, l’agaçante et indébrouillable dualité masculin-féminin.
Selon ses propos, cette passion la prend à dix-huit ans, précisément dans un contexte musical : lors des cours de rythme dispensés à Mudra par Fernand Schirren, qui développait par ailleurs une philosophie très personnelle (Thierry De Mey le décrit comme « un Zarathoustra de la rue Bara, Bruxellois au plus haut point» (4). Schirren enseignait une sorte d’ordre universel régi par l’alternance rythmique élémentaire du Boum et du Hé.
«Le “Hé”, commente Thierry De Mey, désignait le départ du mouvement rythmique, l’émission, le saut, l’arc, et par extension la différence, l’individuation. Le “Boum” désignait le point d’arrivée, le repos, et par extension le Même, le partage.» Anne Teresa, elle, en parle comme d’une «variante du Yin et du Yang, du féminin et du masculin ».
Que son imagination ait été stimulée par ces oppositions, superposables à l’infini, adaptables à tous les champs de l’expérience, cela est certain. Qu’elle ait explicitement élaboré une petite construction à usage personnel où se disposaient, duellement, une constellation musique-forme-nombre-analyse-masculin face à une constellation danse-désir-corps-intuition-féminin, laissons la question en friche. L’essentiel est ceci : aussi passionnément que sa raison méditait et labourait ces innombrables dualités, sa danse les mettait à l’épreuve, les défaisait et les recombinait dans une complexité toujours croissante.
l’auditeur idéal
Le travail de Merce Cunnigham avec John Cage, comme on sait, avait absolument disjoint le lien entre la musique et la danse. La danse se trouvait libre de déployer une autonomie totale, hors de tout codage narratif : pure exultation d’un corps qui, au sommet de la performance technique, oublie pourtant tout ce qu’il sait. Cage avait autorisé cette disjonction par l’étrange qualité neutre de sa musique, où aucun son, même le plus bruyant, ne perd jamais le contact avec le silence d’où il sort. Mais sans l’aide de Cage et de sa folie singulière, à la limite extrême de l’évanouissement de toute musique possible, la danse avait-elle d’autre solution pour préserver sa liberté toute fraîche, que de choisir définitivement le silence ?
Les chorégraphes ont continué, pourtant, de solliciter la musique : non plus sous l’angle de la narration, non plus tout à fait sous l’angle de la disjonction, et tout compte fait sous l’angle du détail : détail d’une texture, d’une densité, d’un frémissement rythmique, d’une évocation souvent, qui puisse entrer en résonance avec l’action sur le plateau. Car tous les rapports sont possibles, après tout.
La spécifité d’Anne Teresa De Keersmaeker est d’avoir refusé la narration et la disjonction, autant que le rapport de détail. Elle aimait la belle forme, et elle a voulu appréhender la musique comme une forme (5). Ce qui devait nécessairement l’amener à croiser les musiciens de « musique contemporaine », plus sensibles que d’autres à cette question difficile : l’écoute d’une oeuvre est-elle l’écoute d’une forme ? L’écoute doit-elle, peut-elle être homogène à l’architecture de l’oeuvre ?
(Parions qu’Anne Teresa De Keersmaaeker représente secrètement, pour beaucoup de musiciens, l’auditeur idéal. La question : « y a-t-il un rapport possible entre la musique et la danse ? – la musique est-elle lisible par la danse ? » est exactement la même que : « y a-t-il une écoute idéale de l’oeuvre, sans distraction, sans rêverie, sans scorie ? »)
un certain flottement
Dans un beau livre paru l’année dernière (6), le musicologue Peter Szendy rend précisément compte des paradoxes liés à l’ordre : « Tu dois écouter ! » - qu’il soit explicite ou intériorisé. Je le cite : «Si l’injonction, dans cet impératif, ne souffre aucune question (tu dois !), l’activité qu’elle prescrit (écouter) m’apparaît de moins en moins définie : qu’est-ce qu’écouter, qu’est-ce que l‘écoute répondant à un tu dois? Est-ce même une activité ? » Analysant ce qu’est historiquement devenu, sur fond de culte religieux voué à Beethoven, le devoir d’écoute du mélomane moderne, il jette le soupçon sur l’idéal d’une écoute pleinement adéquate à l’oeuvre écoutée, ce qu’Adorno qualifiait d’écoute structurelle. Et il pose la question - en faisant comiquement passer la surdité de Beethoven dans le camp de ses prêtres : « On est en droit de se demander, à notre tour, si ladite écoute totale n’est pas précisément une forme de surdité de la part de l’auditeur. Ecouter sans divagation aucune, sans se laisser jamais distraire par « les bruits de la vie », est-ce encore écouter ? L’écoute ne doit-elle pas accueillir en son sein certains flottements ? »
Tout ce livre baigne par ailleurs dans la tristesse d’une solitude : face à l’oeuvre, on est trop seul. Comment faire écouter son écoute_ est sa question. « C’est vrai, j’aimerais chaque fois signer mon écoute . (...) J’aimerais pointer, identifier et faire partager tel événement sonore que personne d’autre que moi, j’en suis sûr, n’a jamais entendu comme je l’ai fait. Aucun doute là-dessus. Et je suis même convaincu qu’il n’y a de l’écoute musicale qu’à la mesure de ce désir et de cette conviction ; autrement dit, que l’écoute - et non l’audition ou la perception - commence avec ce désir légitime d’être signée et adressée. A d’autres. »
Ces deux axes que développe Peter Szendy – la question de l’écoute une et accomplie, et le désir de complémenter son écoute d’une adresse aux autres, il me semble qu’on les retrouve, tout intriqués, dans le travail d’Anne Teresa De Keersmaeker, un travail moins « magistral » et plus fragile qu’il n’y paraît. En plaçant les musiciens sur le plateau, en ne reculant jamais devant le prestige des oeuvres (jusqu’à la Grosse Füge de Beethoven, ce qui en stupéfia plus d’un), en refusant les coupures (elle n’a jamais chorégraphié un « second mouvement », par exemple, toujours des oeuvres complètes), elle a bien sûr brisé la convention du ballet et inventé un type de spectacle où il est posé d’emblée que la musique sera prise au sérieux : qu’on exige pour elle une écoute de concert (une grande écoute). La danse qui se glisse au sein de cet étrange concert (si l’on veut bien voir les choses sous cet angle) apparaît dès lors comme une forme de témoignage mélomane, le compte-rendu en chair et en os d’une expérience d’écoute particulière : l’écoute_ signée_, comme le dit Szendy, d’une oeuvre qui n’a pas été simplement choisie selon les goûts du chorégraphe, ou pour sa force d’évocation, mais spécifiquement désirée en fonction de ce qu’il était possible d’en faire entendre.
Ce qui me touche personnellement là-dedans, c’est que cette écoute, cette capricieuse écoute qui est celle d’Anne Teresa, formaliste et disparate, exaltée et moqueuse, semble d’abord et avant tout fraternellement adressée aux musiciens, à tous ceux que la musique déchire : car tous les musiciens le sont, déchirés, entre le travail décidé sur les oeuvres et le voeu plus secret de s’y abandonner, entre la bonne écoute et la jouissance vagabonde du détail, entre respect et désir, entre forme et fragment. Son spectateur idéal, c’est sans doute le musicien.
les cahiers de Thierry
A propos de ce livre de Peter Szendy, l’historien de l’art Esteban Buch écrit ceci (7) : « L’écoute structurelle, globale, téléologique, non lacunaire, non favorite, non zappée ni samplée ni dévoyée, cette écoute du devoir, je veux bien qu’on s’en débarasse. Il m’arrive souvent de vouloir m’en débarrasser, pour rêver d’un monde sonore où tous les moments seraient mes favoris, ou sinon rien. (...) Seulement, une fois que le modèle sera complètement renversé, peut-être faudra-t-il créer un petit club rétro, qui sera en fait un club d’utopistes, les amateurs d’écoute structurelle, ivres de continuité, de direction, de happy end, de cadences parfaites (...) Découvrir une structure, cela peut être aussi un moment de jouissance. »
Cette dernière phrase m’arrête, elle m’est familière, elle a un visage : ça pourrait être un propos de Thierry De Mey – ça l’a été sans doute. Un large volet des joies intellectuelles d’Anne Teresa reste obscur, si on ne connaît pas sa longue et passionnée fraternité avec Thierry De Mey. Il est intéressant de l’avoir vu, lui, dévoilant ses carnets de peintre Renaissant où s’accumulent les belles formes : séries chiffrées paradoxales, carrés magiques, processus réversibles, extensifs, déceptifs, en spirale, en tresse, en ruban de Möbius... Et l’avoir vu, elle, penchée sur ces esquisses, les chorégraphiant déjà, sans quitter jamais un soupçon d’ironie bienveillante envers l’étrange et désordonné grand frère. C’est toute l’expérience de Kinok : « Découvrir une structure, cela peut être_ aussi_un moment de jouissance ». On peut dire, en reprenant le mot de Szendy : une jouissance qu’Anne Teresa et Thierry s’adressent mutuellement.
chronométrie I
Dans certaines oeuvres récentes, elle emprunte à Cage-Cunningham l’objet caractéristique : le chronomètre. C’est dans In Real Time que son usage est le plus voyant (les spectateurs ne peuvent pas ne pas en suivre le défilement), c’est là aussi qu’il est le plus ambigu. En un sens, il vient renforcer la mythologie Rosas, et rappelle au spectateur qu’il visite un un pays aux moeurs savantes, où se voue un culte à la puissance de la Forme : le temps y est sévèrement découpé, les interventions sont calibrées, les musiciens réservent leur plus beau morceau pour l’instant de la Section d’Or. En un sens opposé, pourtant, le fait que le chronomètre défile à l’envers (de 3 heures au temps zéro) dans un contexte d’improvisation, jette sur l’entreprise un suspens d’un tout autre ordre : nous avons 180 minutes pour que quelque chose advienne, pour que la grâce des improvisations dansées rencontre celle des musiciens, et fasse jaillir quelques étincelles imprévues; ou non. Le mot d’ordre paradoxal de In Real Time, qui conviendrait à tout un pan de l’oeuvre d’Anne Teresa depuis Violin Phase, et qui dirait à la fois la mesure et la perte, pourrait être celui-ci : le temps nous est compté.
chronométrie II
Les danseurs de Rosas ont toujours dû beaucoup compter. Se caler sur des événements musicaux ou sur ses partenaires, c’est rarement suffisant pour exécuter les contrepoints élaborés par Anne Teresa De Keersmaeker, passant en éventail du strict unisson à la multiplication débridée des voix dansées. Compter les répétitions d’un geste, compter les pulsations avant une entrée en canon, compter le temps nécessaire pour exécuter un parcours... et le faire avec aisance... C’est sans doute ce qu’on leur demande de plus difficile (parfois même, disent-ils, d’insupportable).
Dans I Said I, on voit cette scène étonnante où le danseur Martin Kilvády déroule un compte, one, two, three, ..., au micro cette fois, mesurant avec douceur le faisceau enchevêtré des parcours marchés de ses partenaires. Que compte-t-il, au juste ? On ne sait pas trop : la musique qui accompagne cette scène est improvisée en direct par le DJ Grazzhoppa, le tempo est simple... On suppose qu’un élément plus discret, un artifice caché dans la musique, aurait tout aussi bien convenu pour régler la scène. Rien de répétitif et d’hypnotique non plus, comme dans Einstein on the Beach. Non : il compte le temps, il chiffre l’espace, et il faut que cela sonne lorsque la musique se fait toute simple...
comme si
Une hypothèse : c’est l’expérience de l’improvisation, la rencontre avec des improvisateurs, qui l’aura changée. Au fil des expériences d’Anne Teresa De Keersmaeker, le balancement imprévisible, douloureux parfois, entre la contrainte du nombre et le refus de toute forme stable – traduit selon notre propos : oscillation entre le devoir de lire les oeuvres musicales en honorant leur cohérence, et le désir de les aimer à la sauvette, en s’échappant, à tout hasard - ce balancement, donc, trouve peu à peu une manière d’apaisement. Non pas une harmonie, une synthèse, mais un mouvement pendulaire plus doux et plus confiant. C’est qu’un savoir-faire neuf a lentement pénétré sa technique de chorégraphe : l’art de faire comme si.
C’était déjà visible dans la chorégraphie de la Suite Lyrique d’Alban Berg (dans Woud, en 1997), cela s’est confirmé récemment dans Drumming, puis dans Rain (sur Music for Eighteen Musicians de Steve Reich) : l’oeuvre musicale a cessé d’être un mur structurel, et les danseurs ne courent plus s’y cogner de toutes leurs forces - pour en revenir aux mots de Thierry De Mey. De Keersmaeker semble peu à peu avoir renoncé à lire la musique par la danse – à rendre compte, de gré ou de force, d’une lecture - pour désormais en compléter le contrepoint. Ni soumission, ni transgression, ni négligence : mais surenchère. On dirait que son inquiétude l’abandonne, et avec elle son ironie. Quelque chose demeure bien sûr des expériences passées, d’un ancien rapport plus obéissant (et plus moqueur) à l’oeuvre musicale, fait d’exactitude, de correspondances formelles, de concordances temporelles – et, fatalement, de contre-pieds insolents, aussi (comme dans les récentes Noces, fragment presque autonome d_’April Me_ et virtuose reprise au carré du style de Mikrokosmos). Mais tout cela n’existe plus que comme fiction. De la mythologie-Rosas, il ne reste plus rien qu’il faille croire ni dénoncer, car elle se joue désormais d’elle-même : c’est comme si la musique, dans son déploiement polyphonique, dans ses avancées et ses retours, ses anticipations, ses symétries, dans toute son impérieuse occupation du temps, déclenchait les mouvements des danseurs, guidait leurs variations, leurs canons, leurs spirales... Mais en même temps, on voit très bien qu’il n’en est rien : la danse est ailleurs, toujours déjà ailleurs, à déclencher à son tour de nouveaux glissements, à appeler de nouvelles logiques... à l’infini. La Suite Lyrique, Drumming, ce sont pour moi les plus beaux moments de Rosas, d’authentiques expériences de vertige : un chiffrage absurde du temps et de l’espace, qui s’emballe et s’anéantit dans un furieux désir d’illimité. La polyphonie s’ouvre, elle cesse d’être une forme et elle devient mille voix, prêtes à en accueillir mille et une autres.
un souvenir qui flotte
De bout en bout de Drumming comme de Music for Eighteen Musicians, Steve Reich utilise une technique de contrepoint bien précise, où il excelle : de courtes figures musicales se diffractent par de multiples canons serrés avec elles-mêmes, jusqu’à former une texture inextricable, un bloc de polyphonie ; le compositeur opère alors une coupe dans ce bloc et en extrait une figure nouvelle, une « résultante », qui semble ainsi se détacher naturellement de la texture comme un serpent se défait de sa peau. Qu’y a-t-il de commun entre ce procédé et les enchevêtrements d’étoiles et de spirales dessinés sur le tapis de sol, qui guident les déplacements des danseurs dans Drumming (le ballet)? Entre cette technique et le découpage de Rain, où interviennent secrètement les neuf éléments de l’astrologie chinoise, connectés eux-mêmes à un jeu de couleurs et de caractères, contredits par la présence insistante du nombre d’or et de la suite de Fibonacci (8), sans même parler de l’exploration des dualités évoquées plus haut (phrases masculines et féminines, mouvements Yin et mouvements Yang, que sais-je) – bref, à ce fouillis de couches structurelles plus ou moins autonomes – qu’y a-t-il de commun ? Rien, que je sache.
On serait tenté de dire, dès lors, qu’à force de zèle et d’espièglerie, d’étude et de refus, d’admiration et de provocation ; qu’au bout d’un tête-à-tête fasciné avec la musique, désignée d’entrée de jeu comme gardienne de la forme, Anne Teresa De Keersmaeker réinvente finalement la solution de Cage-Cunningham : la disjonction des disciplines, rendues chacune à leur royaume propre. Ainsi traite-t-elle Purcell dans Small Hands : en lui foutant une paix royale. Pas, ou si peu, de correspondances structurelles dans cet assemblage de courtes pièces, pas d’Histoire et de baroquisme, plus de plaisanteries ; mais une oreille flottante, ouverte au jeu des dissonances brassées par le rythme ; et même pas : derrière le rythme, une palpitation de joie ; et derrière cela, rien, un battement, à peine plus que le silence. Cela ferait une bien belle histoire, n’est-ce pas, une épopée morale : la lente conquête de sa liberté par la liberté de l’autre, ou quelque chose de cet ordre.
N’était ce comme si, qui imprègne son dernier style d’une saveur particulière. Ce souvenir qui flotte d’avoir rêvé une adéquation, une concordance, une vraie rencontre. Puis d’avoir fui ce rêve, d’avoir imaginé dans l’urgence des stratégies d’échappement. J’imagine qu’elle n’y renoncera jamais totalement, à ce rêve et à son tourment. A vouloir en découdre avec la musique, crayon rouge à la main. Le théâtre l’en divertit, puis elle y revient. C’est qu’Anne Teresa n’a aucun goût pour les « oeuvres ouvertes » - où l’artiste se contente de disposer des chances, et s’en remet au public pour en apprécier la pertinence. En témoigne le soin particulier qu’elle met à élaborer des débuts et des fins de spectacles nets et frappants, souvent calés sur la musique, signaux visibles de la préméditation de l’oeuvre, et de sa finitude.
bonne fête
Dans le contexte d’anniversaire où s’inscrit ce livre, il est intéressant de savoir qu’Anne Teresa va prochainement chorégraphier ses vieilles cassettes de Joan Baez, « souvenir d’adolescence ».
L’adolescence : on met la musique, on ferme les yeux, on danse, on fait comme si la musique allait diriger, désormais et à jamais, chacun de nos gestes. Puis on laisse tomber : vient le temps d’apprendre, de construire, de savoir.
Rosas fête ses vingt ans, Anne Teresa ses vingt ans de chorégraphe. Quarante-deux ans et deux enfants. Une seconde adolescence.
Juillet 2002
1 Thierry De Mey, entretien avec J.-L. Plouvier. Programme du festival Musica 2001, Strasbourg
2 Ce travail préalable d’analyse se professionnalisera ensuite avec le chef d’orchestre Georges-Elie Octors, qui en est aujourd’hui à son quinzième «syllabus» d’analyse musicale, remis systématiquement en amont de chaque production.
3 Marianne Van Kerkhoven et Rudi Laermans, Anne Teresa De Keersmaeker. Kritisch Theater Lexicon, Vlaams Theater Instituut, 1998
4 Thierry De Mey, texte cité
5 Ce court propos se limite à tenter de préciser le trait le plus spécifique du rapport d’Anne Teresa De Keersmaeker à la musique : un lien à trois termes musique-danse-forme, en entendant par forme tous les procédés de déploiement musical dans le temps qui peuvent s’analyser, voire se mathématiser. Ce rapport, tout acharné qu’il fût, n’a jamais été naïvement exclusif, il a même toujours été impur à des degrés variables – et c’est bien pour cela qu’il y a style. D’autres « nouages » ont été expérimentés, que je passe sous silence : par exemple le lien musique-danse-sens, où les disciplines se rencontrent au travers des poésies utilisées dans la musique vocale, qui suscitent des analogies dans le matériau dansé (dans Mozart / Concert Aria’s), ou des propos d’ordre littéraire, programmatique ou biographique du compositeur (comme dans la Verklärte Nacht sur la musique d’Arnold Schoenberg).
6 Peter Szendy, Ecoute. Une histoire de nos oreilles. Editions de Minuit, 2001
7 texte publié sur le site d’Entretemps : www.entretemps.asso.fr
8 la suite de Fibonacci est la série de nombres qui commence avec 1 et 1, et se développe de telle sorte que tout nouveau terme est l’addition des deux précédents : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... Plus on avance dans la suite, plus le quotient de deux nombres consécutifs donne une approximation précise du nombre d’or, approximation alternativement par dessous et par dessus. Les chorégraphies d’Anne Teresa De Keersmaeker utilisent abondamment cette suite, par exemple pour régler des canons irréguliers.